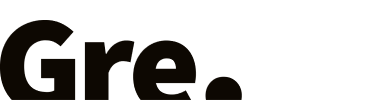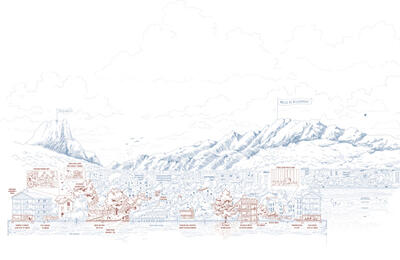Vous êtes agroclimatologue et travaillez aussi sur l’agrométéorologie. Vous pouvez nous expliquer la différence ?
L’agrométéorologue s’intéresse à l’impact de la météo sur les travaux des champs. Je travaille sur un site Internet, agroclimatologie.com, qui est gratuit, où les agriculteurs peuvent par exemple être alertés du risque de gel sur leurs cultures et du pourcentage de perte probable à court terme. Je vais également y développer le stress thermique des animaux d’élevage à 5 jours, le risque de maladies selon les conditions de pluie et de température, etc.
L’autre partie de mon travail, c’est l’agroclimatologie, qui regarde sur le long terme. Cela consiste à savoir si en 2050, il y aura encore des vaches laitières dans les Alpes, si la noix de Grenoble poussera encore dans la vallée ou si elle sera remplacée par l’olive… L’agroclimatologie fait intervenir le socio-économique, le politique et l’agriculture en même temps. Elle aide à la décision de la création de filières ou de leur mise en valeur, de l’investissement dans tel ou tel domaine de recherche. Elle concerne l’enjeu de la souveraineté agricole face aux aléas.
On dirait justement qu’il y a de plus en plus d’aléas sur nos cultures…
Oui et les chiffres en témoignent. En 2021, à cause du gel, nous avons eu 2 milliards de pertes dans l’agriculture fruitière. Pas tant du fait du gel tardif que d’une floraison très précoce d’ailleurs. En 2022, nous avons eu plusieurs centaines de millions de pertes à cause de la sécheresse, la deuxième la plus intense en 100 ans. À l’inverse, en 2023-2024, nous avons eu des excès d’eau, provoquant une saison extrêmement déficitaire pour les céréales notamment, ramenant le rendement du blé à son niveau des années 1990. Donc les aléas s’enchaînent. L’une des caractéristiques du changement climatique, c’est qu’il accentue les phénomènes et accélère leur répétition. On n’est même pas encore sur de la projection climatique, on est sur un constat de difficultés accrues.
Est-ce à dire que la réalité dépasse déjà les prévisions ?
Nous sommes encore dans les prévisions du GIEC, dans la tranche haute, qui nous emmènera à + 4 °C en 2100 en France. Les toutes prochaines années seront observées à la loupe par les climatologues. En tous cas, le Plan national d’adaptation à un réchauffement de + 4 °C en 2100 est contestable. S’adapter à une hausse probable de 2,7 °C d’ici 2050, c’est encore faisable : avec de nouvelles variétés de maïs moins consommatrices d’eau, avec de nouvelles pratiques du sol, avec la maîtrise de microclimats sur les parcelles, par exemple.
En revanche, + 4 °C en France en 2100 rend toute adaptation impossible. Des événements ponctuels seront dévastateurs pour l’agriculture. Des pointes à 48 ou 50 °C constituent un problème physiologique majeur pour les cultures, parce qu’à cette température, les feuilles brûlent. Il y a une limite biologique qu’il ne faut pas dépasser. La meilleure façon de s’adapter à + 4 °C est de ne pas les atteindre. Et la seule solution consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Est-il facile de convaincre le public de l’urgence, quand le climatoscepticisme semble avoir de beaux jours devant lui ?
Je suis très souvent sur les réseaux sociaux pour combattre les idées fausses. Lorsqu’une personne prétend que les glaciers ne fondent pas, ce qui est bien sûr totalement faux, je ne cherche pas à la convaincre. En revanche, le climatosceptique ne doit pas contaminer les autres. Contrairement à une idée assez répandue, il y a beaucoup moins de climatosceptiques parmi les agriculteurs que dans les autres professions. Car ils sont les observateurs du vivant.
Leur thermomètre, ce n’est pas le CO2, c’est ce qu’ils constatent autour d’eux : le retour précoce des oiseaux migrateurs, les premières floraisons, le premier chant des cigales, etc. Les climatosceptiques, très présents dans certains médias, ont cette particularité commune de n’avoir fait aucune étude en lien avec la nature, les écosystèmes ou le climat. Ce qui devient très grave aussi, c’est que le pouvoir politique tend à s’imposer au savoir scientifique, par idéologie ou pour des raisons économiques à court terme. Alors que le politique doit d’abord veiller à notre alimentation et à notre bien-être à long terme.
à lire en complément
l’agenda associé
- du Samedi 10 mai au Samedi 17 mai
Palais des Sports Pierre Mendès France