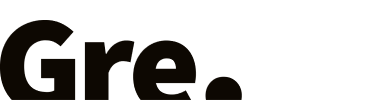Il semble que l’écologie régresse dans les programmes politiques de nombreux pays, dont le nôtre...
Il y a en effet un reflux de l’écologie dans le débat politique, notamment en raison de crises économiques et sociales qui prennent le dessus dans les préoccupations immédiates. C’est ce que nous avons prédit (voir, par exemple, Comment tout peut s’effondrer, écrit avec Raphaël Stevens) : plus on entre dans l’urgence, plus on se concentre sur l’immédiat et le court terme et plus on devient myope, on augmente alors les chances d’effondrement.
Cette hiérarchie des priorités est une illusion dangereuse, car les grandes crises systémiques qui paraissent lointaines sont très graves : le climat, l’effondrement écologique et la fragilité de nos sociétés. Lorsque Donald Trump ou d’autres leaders prônent un retour au pétrole, ils ne font qu’accélérer le désastre. Ils croient se sauver eux seuls à court terme, mais condamnent le collectif à long terme. C’est comme investir dans l’air conditionné pour traverser le dérèglement climatique, le confort égoïste instantané aggrave le problème général.
Dans notre dernier livre Le Pouvoir du Suricate (avec Nathan Obadia, NDR), nous donnons des clés pour apprendre à apprivoiser nos peurs, précisément pour continuer à voir le tableau global et à agir ensemble.
Nous sommes en train de vivre une collision frontale entre préservation du vivant et préservation de notre société capitaliste, qui nous a permis d’accéder à un certain confort : peut-on encore en réduire les effets mortifères ?
Le capitalisme s’est construit sur l’exploitation illimitée des ressources humaines et terrestres au profit d’une petite caste. Ce modèle est aujourd’hui en train de se heurter à la finitude du monde, c’est-à-dire qu’il provoque littéralement la fin du monde!
Oui, bien sûr, on peut toujours réduire ces effets mortifères. Mais, pour cela, il faut construire une capacité à changer de regard et à faire un pas de côté par rapport au système. On ne peut pas changer le système depuis le centre. Il faut cultiver les marges, grâce à des individus conscients, par des alliances, et surtout des choix politiques : relocalisation de l’économie, décroissance des secteurs polluants, horizontalité dans les structures, entraide à toutes les échelles, etc. Les solutions ne manquent pas, mais il y a beaucoup de verrouillages systémiques et politiques. Il y aura donc aussi, très probablement, des conflits et des rapports de force à tenir.
Comment les villes peuvent-elles accélérer la transition écologique ? Comment la faire accepter auprès des habitant-es ?
Si l’on considère que la transition écologique, c’est sortir vraiment des énergies fossiles, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ! Car, même les énergies dites renouvelables consomment énormément d’énergies fossiles pour leur fabrication et pour extraire les matériaux. Les villes modernes sont fortement dépendantes aux « énergies faciles ». Réduire l’afflux énergétique va donc transformer complètement la structure et le métabolisme de nos villes, et c’est ça qu’il faut anticiper. Il y aura forcément un exode urbain et une période chaotique.
Mais qui dit chaos dit réorganisation, innovation et finalement possibilité de vrai changement. Il faut faire le deuil de la ville telle qu’on la connaît, et donc revoir radicalement les choses : repenser des espaces plus collectifs (la densité humaine est le grand problème et aussi la grande force des villes), moins de machines, plus de végétalisation, de circuits courts, de coopératives, de liens avec les campagnes, etc. Il ne faut pas avoir peur du chaos, il est source de créativité et donc de résilience. Quand une forêt brûle, l’avenir est dans les petites pousses, ces plantes pionnières qu’on appelle « mauvaises herbes », dans cette phase chaotique de réorganisation. Ce sont elles qui préparent le sol pour les futures forêts. Soyons des mauvaises herbes, inventives, audacieuses et solidaires !
Conférence par Pablo Servigne et Laure Noualhat
En 2025, continuer de se mobiliser pour le vivant, pour la démocratie et pour la paix peut sembler à la fois vital et effrayant. Comment se mettre en mouvement ? Venez participer aux côtés des intervenant-es à cette réflexion qui reviendra sur l’importance des liens, de l’entraide et de l’ancrage territorial, entre résistance et résilience.
Dimanche 11 mai, de 20h à 22h au Palais des Sports
à lire en complément
l’agenda associé
- du Samedi 10 mai au Samedi 17 mai
Palais des Sports Pierre Mendès France