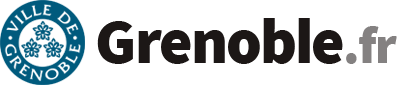Le Théâtre de La Résistance
Dès 1941, le Front national de lutte pour l’indépendance de la France issu du Parti communiste clandestin ainsi que les mouvements Combat, Libération et Franc-Tireur – qui plus tard sera à l’origine des premiers camps dans le Vercors - s’implantent à Grenoble.
Année 1942
Au 63, avenue Alsace-Lorraine, le Comptoir Lyonnais est tenu depuis 1934 par Louise et Jacques Collomb. Ce café-brasserie devient à partir de 1940 le point de rencontre des « patriotes » hostiles au régime de Vichy. Dès janvier 1942, le premier tract de Combat est remis à Louise Collomb par un ami client, Charles Bernard Guelle, géomètre au service du cadastre. Le Comptoir Lyonnais servira alors de lieu de réunion ainsi que de « boîte aux lettres » au mouvement.
Les tracts et journaux sont acheminés par le train en provenance de Lyon et déposés au Comptoir sous forme de paquets commerciaux par des voyageurs "amis". Ils feront de Louise Collomb l'une des dépositaires de la presse clandestine.
En 1942, la Compagnie Française Thomson-Houston est installée au 14, rue du Drac. Son chef des ateliers de mécanique s'appelle Robert Favier. Né le 28 janvier 1914 à Grenoble, il sera "Mattras" dans la Résistance et devient l'adjoint du Commandant Nal. En contact avec l'équipe du CDM (Camouflage du matériel) du parc d'artillerie, il récupère les fusils et les pistolets mitrailleurs sabotés et soustraits à la Commission d'armistice italienne. Malgré l'Occupation, Robert Favier parvient à remettre en état toutes ces armes. Elles équiperont par la suite les groupes francs et plusieurs maquis.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pasteurs Jean Cook (1899-1973) et Charles Westphal (1896-1972) prêchent régulièrement dans le temple protestant, 2 rue Joseph-Fourier. Tous deux refusent la politique antisémite du gouvernement de Vichy. Ils accueillent de nombreux Juifs, participent à leur sauvetage et à leur passage en Suisse. Dans la salle annexe, derrière le temple, il y a une trappe qui mène à une ancienne cave à charbon, sous la chaire. C'est là que des prisonniers de guerre anglais, échappés d'un camp d'internement, trouvent une cachette pendant quelques jours en 1942, grâce à l'initiative du concierge du temple, M. Brachon, et avec l'aide de Donald Caskie, pasteur écossais. Par la suite, un certain nombre de Juifs l'utilisent à leur tour en attendant de bénéficier des filières de passage vers la Suisse.
Le Mouvement de la Jeunesse sioniste (MJS) naît à Montpellier le 10 mai 1941 dans un objectif premier de résistance. Ses fondateurs, Joseph Fischer, Otto Giniewsky et Dyka Jefroykin, cherchent à « rassembler les jeunes Juifs dans un esprit de résistance morale par l'éducation, par la connaissance du judaïsme et par une fraternité d'idéal sioniste ». La section du MJS de Grenoble établit son siège cours Jean-Jaurès en 1942. Reconnue comme l'une des plus actives de la Résistance juive, elle est dirigée par Otto Giniewsky, dit Toto, étudiant au sein de l'institut d'électrochimie basé boulevard Gambetta, et Georges Schnek.
Au sein des Éclaireurs Israélites de France (EIF) est créé clandestinement en août 1942, à Grenoble, le Service social des jeunes. Le SSJ organise le passage en Suisse des enfants étrangers de plus de quinze ans. Il cache d'autres enfants dans les hospices de Saint-Laurent-du-Pont et de Saint-Marcellin, chez les Petites Sœurs des Pauvres à La Tronche, à l'Hôpital de La Tronche, au Sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet et chez les Sœurs de Notre-Dame-de-Sion, à Grenoble. Ses principaux responsables sont Maurice Chouraki, le rabbin Zundel Eichisky, André Kalnaï, Liliane Klein-Lieber et Jean-Claude Lieber. Leur siège est établi au 7, rue Jean-Jacques Rousseau. Le SSJ bénéficie, à Grenoble, de l'aide de Marguerite Morche du Foyer de l'Étudiante de Grenoble, de M. Dormoy du Secours national, d'Isaure Luzet de la pharmacie du Dragon, de Sœur Joséphine de Notre-Dame-de-Sion, et du principal du collège de Tullins.
Année 1943
Les FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans - Main-d'œuvre immigrée) dépendent des FTP (Francs-Tireurs et Partisans), c'est-à-dire la branche armée du Front national de la Résistance (PCF clandestin). La plupart des membres des FTP-MOI sont des militants juifs communistes, provenant majoritairement d'Europe centrale. Ses membres cachent leurs armes et leurs munitions au 2, rue du Docteur-Hermite.
Le bataillon Liberté des FTP-MOI est fondé en mars 1943 par Marcel Gaist (alias Marcel Gaubert), étudiant juif d'origine hongroise. Celui-ci meurt quelques mois plus tard, le 7 juillet 1943, lors de l'attaque de la biscuiterie Brun à Saint-Martin-d'Hères.
En mars 1943, une école de cadres de la Milice est créée à Uriage, forte d'une centaine d'instructeurs. L'enseignement porte à la fois sur la doctrine, qui oscille entre la Révolution nationale et le national-socialisme, et sur les techniques de combat.
Les ennemis de la collaboration, que le régime de Vichy nomme "l'anti-France", sont d'abord incarcérés à la prison Saint-Joseph, 9, boulevard Agutte-Sembat, puis conduits dans un camp d'internement, en Isère, à Fort-Barraux, ou détenus en centrale après condamnation. Comme celle de Saint-Étienne, où nombre de militants communistes se trouvent avant d'être transférés à la centrale d'Eysses (Lot-et-Garonne).
Dès 1942, Isaac Schneersohn, alors réfugié à Grenoble, souhaite réunir les représentants des principales instances juives en France. Objectif : proposer la création d'un centre de documentation et constituer les archives de la répression antisémite. Il parvient, le 28 avril 1943, à rassembler à son domicile du 42, rue Bizanet une quarantaine de délégués en provenance de Saint-Étienne, Nice, Lyon, Marseille et Paris. Avec eux, ils fondent le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), qui donnera naissance peu après au Conseil représentatif des Israélites de France (CRIF). Établi aujourd'hui à Paris, le CDJC est le centre de documentation le plus important d'Europe sur la Shoah.
Sous l'Occupation, le couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut est désaffecté. La ville de Grenoble, qui en est propriétaire, y loue des logements, occupés en grande partie par des familles d'origine italienne, sous le contrôle de M. Lanfrey, ami lui-même du docteur Léon Martin. Le dédale des étages et les dépendances multiples de cette vieille bâtisse offrent de nombreuses cachettes. Elles sont mises à profit pour entreposer des armes et des munitions, ainsi que de grandes quantités de tracts, revues, journaux et autres livres clandestins. Le couvent abrite aussi un dépôt de La France Intérieure, journal de la presse clandestine de la Résistance, grâce à Fernand Rude, l'un de ses principaux collaborateurs.

Par ailleurs, les correspondants grenoblois du grand réseau de renseignement Alliance y transfèrent leur siège en août 1943, après avoir œuvré un temps dans un restaurant de la rue Lafayette. D'où leur nom de code, "Restaurant".
En septembre 1943, quand les troupes allemandes occupent le département, une section armée investit le gymnase au 4, rue Berthe-de-Boissieux, face à la caserne de Bonne. Parmi les soldats présents se trouvent des Yougoslaves et des Polonais, incorporés de force dans la Wehrmacht. Le directeur du gymnase Georges Sapin, dit Bois, se lie avec eux. Membre du mouvement Combat dès octobre 1942 puis de l'Armée secrète l'année suivante, Georges Sapin est un proche de Paul Vallier. Il lui apporte aide et soutien logistique. Il comprend le profit que la Résistance peut tirer de cette situation.
Le Slovène Alexandre Percic et le Polonais Aloyzi Kospicki, vont livrer de précieux renseignements. Notamment que les égouts de la caserne de Bonne ont été obstrués par les troupes italiennes, présentes jusqu'en septembre 1943. Or, c'est par là qu'Aimé Requet, adjoint de Louis Nal, souhaitait s'introduire pour faire exploser les dépôts de munition du site militaire. Après l'explosion du polygone d'artillerie du 14 novembre 1943, une partie des munitions de l'occupant nazi, encore intactes, ont été transférées ici.
Aloyzi Kospicki se porte volontaire pour poser les détonateurs que lui fournit Georges Sapin le 1er décembre 1943. L'attentat est programmé le lendemain entre 2h et 4h du matin. Il a lieu finalement à 8h10 et entraîne plusieurs explosions jusqu'à 11h30.
Le 6 octobre 1943 au matin, l'ingénieur André Abry est abattu devant son domicile rue de Palanka. Son fils Pierre-Henri est âgé de 10 jours. Alors qu'il doit poser sa serviette pour soulever le rideau de fer de son garage, un soldat allemand en poste près de là se sent menacé et lui tire dessus. Il s'écroule, atteint à l'épaule et perd son sang en abondance. Les Allemands interdisent aux nombreux passants de lui porter secours. Il meurt en arrivant à l'hôpital. André Abry devient un véritable symbole de l'oppression aveugle dont sont victimes les Grenoblois. Le 9 octobre, les obsèques d'André Abry donnent lieu à une grande manifestation. Des milliers de personnes y assistent malgré la présence des mitraillettes de l'envahisseur.
Guy Eclache devient, en novembre 1943, responsable régional des Jeunes de l'Europe nouvelle (JEN), mais aussi recruteur pour la Waffen-SS et agent du SD. Dans une villa de la rue Henri-Ding, à proximité du siège du SD, la débauche se tient au premier étage, la torture au second. Durant plusieurs mois, Guy Eclache opère avec le Service spécial de la Milice et Julien Berthon, le chef milicien, considéré avec cynisme comme un « tortionnaire de talent ». Les personnes arrêtées, lorsqu'elles survivent, sont remises aux Allemands.
En juin 1944, Guy Eclache structure les Jeunes de l'Europe nouvelle (JEN) de Grenoble en un groupe armé d'une trentaine d'hommes. Pendant les trois derniers mois de l'Occupation, ceux-ci vont multiplier les exactions, torturant, assassinant et pillant à Grenoble et dans sa région pour le compte des nazis. Celui qu'on surnomme le Lieutenant « Luc Siffer » acquiert une telle réputation de tortionnaire et de tueur au service des Allemands qu'il en vient à être nommé, à la Libération, l'"ennemi public numéro 1" des milieux résistants. Guy Eclache sera jugé le 27 septembre 1947 par la cour de justice de l'Isère et exécuté publiquement le 20 octobre de cette même année.
Comme en 1942, les « patriotes dauphinois » sont appelés à un rassemblement à Grenoble le 11 novembre 1943 en souvenir de la victoire de 1918, malgré l'interdiction des autorités. Informés que l'occupant est prêt à employer la force, certains responsables de la Résistance tentent en vain d'annuler le mouvement qui regroupe le matin quelque 2 000 personnes. Parmi eux, de nombreux travailleurs qui ont cessé leur activité. S'étant vus interdire l'accès au monument aux morts de la Porte de France par la police, ils se dirigent aux cris de « Vive de Gaulle » vers le monument des Diables-Bleus, parc Paul-Mistral, non sans avoir sifflé le siège de la Milice place Victor-Hugo. Les manifestants placent un drapeau tricolore sur la statue et entonnent La Marseillaise. Au moment où la police intime l'ordre de la dispersion, des colonnes de soldats allemands surgissent de la Maison des étudiants place Pasteur où se trouve l'état-major de l'occupant. La police les empêche de tirer sur la foule. L'étau se resserre sur un millier de personnes. Vers 17 heures, policiers, femmes et enfants sont relâchés tandis que les hommes sont emmenés à la caserne de Bonne. Près de 400 d'entre eux sont déportés. 120 seulement survivront aux camps de concentration.
De tous les partis de de la Collaboration, le Parti franciste est le plus ancien. Il est créé par Marcel Bucard le 29 septembre 1933 et le seul à toujours s'être affirmé fasciste. Il est établi au 1, rue du Palais. Son représentant à Grenoble est Antoine Girousse, membre du SD. C'est à partir des renseignements fournis par des membres grenoblois du parti que va s'organiser la "Saint-Barthélémy grenobloise" entre le 25 et le 30 novembre 1943.
Employé du génie civil, Roger Guigue participe au CDM (Camouflage du matériel), sous les ordres de Louis Nal. Il est arrêté le 25 novembre 1943 vers 18 heures au salon de coiffure de sa femme, 15, rue Brocherie. Son corps est retrouvé le lendemain à Meylan (Isère).
Ancien militaire, Georges Duron vend des billets de la Loterie nationale tandis que sa femme tient une boutique de fleurs, place Victor-Hugo. Membre du réseau Gallia, il est arrêté le 25 novembre 1943 à 18h30 dans le magasin de son épouse. Il se débat, est assommé et conduit dans la traction des hommes du milicien Francis André. Son corps sera retrouvé à Varces.
Le 26 novembre 1943, le docteur Jacques Girard, membre des Mouvements Unis de la Résistance (MUR), est arrêté à 14h à son domicile, 60, rue Élisée-Chatin. Son corps est retrouvé au hameau de Malhivert, à Claix.
Le docteur Henri Butterlin est arrêté le 26 novembre 1943 à 15h à son domicile, 5, rue de Palanka par une équipe de la Milice. Son corps est retrouvé aux Garcins, à Vif. Il a été dénoncé aux services allemands pour propos gaullistes par André Girousse, franciste et collaborateur du SD de Lyon. Il était l'époux de l'assistante du médecin.
C'est aussi à cette adresse que sont arrêtés le docteur Gaston Valois et sa secrétaire Suzanne Ferrandini le 27 novembre à 2h du matin. Peu après, c'est au tour d'Henri Maubert, que le docteur Valois a caché sous un faux nom à la clinique des Alpes à La Tronche d'être arrêté. Déporté, il reviendra des camps nazis.
Le 26 novembre à 17h30, Alphonse Audinos est arrêté au 22, cours Berriat. Ingénieur électricien, il est membre de l'ex SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière) et ancien conseiller municipal socialiste de Grenoble. Son corps est retrouvé, chemin de Ronde, entre les rues Abbé-Grégoire et Ampère.
En début de soirée, le 26 novembre 1943, Joseph Bernard est assassiné devant son domicile du 26, place Vaucanson sous les yeux de sa fille et de ses petits-enfants. Il était agent d'assurances et gendre du lieutenant Berteaux, du Parc d'Artillerie, et l'un des responsables du CDM (Camouflage de matériel).
Le 27 novembre 1943 au matin, le milicien Francis André et son équipe mettent en place une véritable souricière à la « boîte aux lettres » du mouvement Combat, chez le photographe Boninn-Arthaud, au 1, rue de Strasbourg. Au fil de la journée sont arrêtés Edmond Gallet, étudiant et membre de l'Armée Secrète, décédé en déportation, René Mauss, déporté et mort à Auschwitz, Anthelme Croibier-Muscat, membre du Groupe Franc Vallier, miraculeusement libéré de Drancy, Gustave Estadès, également membre du groupe Vallier, déporté, qui reviendra des camps, et les époux Boninn-Arthaud, dont seule Marcelle survivra à la déportation.
Le 27 novembre, à midi, le docteur Henri Arbassier, déjà incarcéré par les Italiens d'avril à juillet 1943, est arrêté à son domicile du 20, avenue Alsace-Lorraine. Détenu à Montluc, puis à Fresnes, il sera libéré fin août 1944.
Le 29 novembre 1943 à 16h, Jean Perrot, chef départemental du mouvement Franc-Tireur, est abattu dans son bureau à son usine, 40, chemin Bresson.
Le 29 novembre 1943 à 18h30, Maurice Taccola, ajusteur-mécanicien au sein de l'usine ARaymond est arrêté au domicile de Jean Perrot, 2, rue Jean-Macé. Il est membre du mouvement Franc-Tireur. Déporté, il ne reviendra pas des camps nazis.
Le 16 décembre 1943, lors d'une réunion politique, Jean Briewski, responsable grenoblois de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et Julius Zerman, alias Julien Samois, sont arrêtés au 12, rue de Bonne. Ils sont tous les deux tués lors de cette arrestation. Ils appartenaient à la section juive de la Main-d'œuvre Immigrée (MOI).
Jeudi 23 décembre 1943, une vaste opération de police est organisée à Grenoble, en réponse à l'exécution d'un soldat, selon les déclarations de l'état-major allemand. À 11 heures, des troupes de la police nazie bloquent les issues de la place Vaucanson où se situe la Poste centrale. Le public qui effectue des opérations aux guichets ainsi que les passants sont arrêtés et transférés à la caserne Bayard pour un contrôle d'identité. Deux cent personnes sont arrêtées, dont six femmes.
En fin de journée, les hommes de moins de dix-huit ans et de plus de quarante ans sont libérés, tout comme les pères de famille non juifs, après "inspection physique". Les Juifs sont incarcérés. Une centaine de personnes seront déportées, dont vingt Juifs.

Année 1944
Le 31 janvier 1944, le bataillon Liberté des FTP-MOI attaque un détachement de 150 soldats allemands au moyen de mines électriques, à l'angle de la rue Branly et du quai Claude-Bernard. L'attentat fait quinze morts et trente blessés. En représailles, la Wehrmacht rafle cinquante personnes le 1er février 1944 et les déporte, parmi lesquelles Pierre Benielli, l'un des responsables départementaux du Noyautage des administrations publiques (NAP).
Chaque rafle répond à un schéma similaire : des camionnettes allemandes chargées de soldats ou de policiers du SD cernent les lieux préalablement sélectionnés (place, hôtel, immeuble, bâtiment...), mitraillette au poing. Des Allemands en civils, ou dans d'autres cas des miliciens, arrivent en voiture. Ils font irruption dans le bâtiment et braquent leurs armes sur les personnes qui se trouvent là. Les victimes sont souvent prises au hasard. Ils procèdent ensuite aux arrestations et transfèrent les prisonniers au siège du SD, cours Berriat, qui sont ensuite déportés en Allemagne. C'est ce qui s'est passé le 19 février 1944 au café de la Table Ronde, place Saint-André.
Sous l'injonction du général de Gaulle, des réseaux sont mis en place dans la France entière dès le mois de juin 1940. Tous dépendent directement du Bureau central de renseignement et d'action (BCRA) de la France libre, basé à Londres. La plupart de ces réseaux bénéficient de l'aide des services secrets britanniques, qui les financent et leur fournissent émetteurs radios, liaisons aériennes et autres moyens substantiels.
Le réseau Gallia regroupe en 1943 sept régions qui couvrent l'ensemble de la zone sud. Il intègre plusieurs sous-réseaux, notamment le réseau belge Reims-Noël. En mai 1944, l'antenne de Chambéry est quasiment détruite et son chef Georges Oreel est abattu le lendemain à Chignin-les-Marches. L'antenne est alors transférée à Grenoble, au café du Modern cours Berriat. Un certain Pierre Fugain en devient le chef-adjoint.
Les GF (Groupes Francs) constituent la branche armée de la Résistance. À partir de mai 1944, un Comité d'action immédiate coordonne ces différents groupes francs, sous la direction de Louis Nal. On peut citer entre autres actions la prise d'armes de la Justice de Paix, où siégèrent durant quelques mois les juges de Grenoble, au 7, quai Créqui, le 13 juin 1944. Un dépôt d'armes y a été caché à l'insu des troupes allemandes. Afin de les récupérer pour équiper la Résistance, et tandis que l'occupant est sur le qui-vive après le débarquement de Normandie, le groupe franc fait croire à un déménagement. Avec deux camions, les résistants chargent de grands sacs qui contiennent les armes et les munitions. Ils sortiront de Grenoble et rallieront Vizille sans rencontrer de contrôle allemand.
Après la "Saint-Barthélemy grenobloise", le Commandant Descour, chef d'état-major de la région R1 du gouvernement provisoire, désigne Albert Seguin de Reyniès pour remplacer Albert Reynier. Mais Reyniès peine à s'imposer en sa qualité de chef de l'Armée Secrète (AS). Il ne parvient pas à placer sous son autorité les FTP (Francs-Tireurs et Partisans). Ce n'est qu'en 1944 que les deux forces armées de la Résistance se regroupent au sein des FFI.
Suite à une dénonciation, Albert Seguin de Reyniès tombe le 6 mai 1944 dans un guet-apens en venant relever son courrier à l'hôtel de la Division Alpine, place de Verdun. On ne le reverra pas. Le commandant Alain Le Ray lui succède le 13 mai 1944 en tant que chef des FFI (Forces françaises de l'intérieur) pour l'Isère.