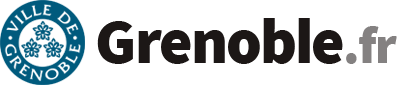De André Abry à Marcelle Boninn
André Abry
1911 (Nantes) - 1943 (Grenoble)
Première victime civile de l'occupation allemande
Ingénieur diplômé de l'aviation, André Abry est affecté en 1939 à la 55e escadre d'aviation de grande reconnaissance, à Lyon-Bron (Rhône). Après la mobilisation, il obtient son brevet de commandant d'aviation alors qu'il est basé à Clermont-Aulnat (Puy-de-Dôme). C'est en 1940 qu'il regagne Grenoble pour travailler au sein du laboratoire d'hydraulique des Ateliers Neyret-Beylier et Piccard-Pictet. C'est aussi l'année où il épouse Marie Provence, dont il aura un fils en septembre 1943. Le 6 octobre 1943, une sentinelle allemande en faction l'abat sans sommation alors qu'il rentre chez lui. Une importante manifestation spontanée se déroule le jour de ses obsèques. Une plaque est apposée rue de Palanka (centre-ville) où il fut assassiné.
Berty Albrecht

"Victoria"
Issue d'une famille d'origine suisse, elle passe un diplôme d'infirmière en 1912 et exerce durant la Première Guerre mondiale dans les hôpitaux militaires.
En 1931, elle devient membre de la Ligue des Droits de l'Homme, s'intéressant particulièrement à la condition féminine. Elle crée en 1933 la revue Le Problème Sexuel, dans laquelle elle défend notamment le droit des femmes à l'avortement libre.
En 1941, elle dactylographie les premiers bulletins de propagande du Mouvement de Libération Nationale. Cette même année, Berty Albrecht est nommée par le ministère de la Production industrielle et du Travail pour s'occuper des problèmes liés au chômage féminin dans la région lyonnaise.
Torturée
Poursuivant sous le pseudonyme Victoria ses activités de résistance au sein du mouvement Combat, elle est arrêtée en janvier 1942. Relâchée, elle quitte alors son poste au ministère. Une nouvelle fois arrêtée fin avril, elle est internée à Vals-les-Bains puis transférée à la prison Saint-Joseph de Lyon, où elle est condamnée à six mois ferme.
Après l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942, elle simule la folie pour échapper au sort réservé aux condamnées pour fait de résistance. Envoyée à l'asile psychiatrique de Bron le 28 novembre 1942, elle est libérée par un commando.
De nouveau arrêtée à Mâcon le 28 mai 1943 par la Gestapo, elle est torturée et transférée à la prison de Montluc, à Lyon, puis à Fresnes. Trois jours plus tard, elle se donne la mort par pendaison.
Berty Albrecht repose dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, à Suresnes. Elle compte parmi les six femmes nommées Compagnons de la Libération.
Lucie Aubrac

"Catherine"
Née Lucie Bernard, elle est licenciée ès Lettres et obtient l'agrégation féminine d'Histoire.
Parallèlement à ses études et à son métier de professeur, Lucie Aubrac milite depuis 1932 aux Jeunesses Communistes. Elle fréquente aussi des associations pacifistes et étudiantes.
Professeur à Strasbourg, elle y rencontre Raymond Samuel, alias Raymond Aubrac, qu'elle épouse en 1939.
En juin 1940, Raymond Aubrac est fait prisonnier de guerre par les Allemands et retenu à Sarrebourg. Deux mois plus tard, elle organise son évasion.
Réfugié à Lyon, le couple participe à différentes actions : diffusion de tracts, sabotages, recrutement de nouveaux membres pour La Dernière Colonne, organisation anti-nazie et anti-vichyste...
Par la suite, les époux Aubrac prêtent main forte à Emmanuel d'Astier de La Vigerie pour la parution du journal Libération et à la création du mouvement Libération-Sud.
Tous deux écrivent sous de faux noms et organisent les réunions du mouvement chez eux malgré les fouilles de la Gestapo. Lucie fabrique également de faux papiers et organise le passage des résistants à travers la ligne de démarcation.
Militante pour les Droits de l'Homme
En juin 1943, elle est arrêtée par la Gestapo, avec notamment Jean Moulin. Lucie Aubrac réussit le faire évader et poursuit sa participation aux actions de Libération-Sud.
Le 21 octobre, elle attaque avec ses compagnons le camion qui transfère des prisonniers et libère son mari ainsi que treize autres résistants.
Recherchée par les nazis, elle parvient à rejoindre Londres en 1944 avec son mari. Elle s'exprimera plusieurs fois sur les ondes de la BBC, notamment pour parler aux femmes et louer leurs combats. Sa vie durant, elle militera au sein de la Ligue des Droits de l'Homme et apportera son témoignage auprès de nombreux élèves de France à propos de la résistance et de la liberté.
Joséphine Baker

"J'ai deux amours"
Freda Josephine McDonald, alias Joséphine Baker, est une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française d'origine américaine.
Durant la Seconde Guerre mondiale, elle joue un rôle important dans la Résistance française. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker met son talent musical à contribution en chantant pour les soldats au front. En septembre 1939, elle devient un agent du contre-espionnage français.
Après la bataille de France, elle s'engage dans les services secrets de la France libre. Installée au Maroc entre 1941 et 1944, elle soutient les troupes alliées et américaines et se lance dans une longue tournée en jeep, de Marrakech au Caire, puis au Moyen-Orient, de Beyrouth à Damas. Elle y glane un maximum d'informations auprès des officiels qu'elle rencontre. Elle s'acquitte de missions importantes, dissimulant des messages dans ses partitions musicales.
Elle reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la croix de guerre 1939-1945 avec palme des mains du général Martial Valin, à la suite de l'intervention du ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas.
En 2021, près de cinquante ans après sa mort, Joséphine Baker entre au Panthéon.
Raymond Bank
1895 (Ivry-sur-Seine) - 1944 (Grenoble)
Journaliste engagé
D'une famille d'origine juive, Raymond Bank est vétéran de la Première Guerre mondiale, plusieurs fois blessé. Il exerce le métier de journaliste au Maroc puis à Grenoble au journal La Dépêche Dauphinoise. Engagé dans l'armée en 1939, il retrouve son métier suite à l'armistice et rejoint rapidement la Résistance et le mouvement Combat. Il devient chef du deuxième bureau de l'Armée Secrète de l'Isère. Arrêté le 4 mars 1944 à Grenoble, il est aussitôt exécuté.
Paul Billat

Des FTP aux FFI
Il rejoint Grenoble à l'âge de 18 ans pour apprendre le métier de confiseur. En 1928, il participe à la fondation du journal Le Travailleur Alpin. Suite à ses articles, il est condamné à la prison.
De 1933 à 1938, il est secrétaire du Parti Communiste Français en Région des Alpes.
Arrêté à Vizille, il est interné au camp de Fort-Barraux en 1940. Transféré au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn en 1941, il s'en évade en mars 1943. Il se réfugie à Malleval dans le Vercors où il contribue à la création d'un maquis FTP (Franc-Tireur et Partisan) avec Raymond Perinetti.
En 1943, il est désigné par le comité militaire de la zone sud pour participer à l'organisation et à l'action du comité militaire FTP de la région méditerranéenne. Le 25 février 1944, il est muté à l'état-major interrégional des FTP de la région Centre où il prend part à la constitution de l'état-major des FFI en juin 1944. Il devient député de l'Isère, de 1947 à 1958.
Jean Bistési
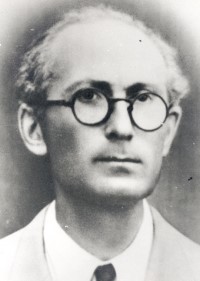
"Mutte", "Besson"...
Il est ingénieur en électrochimie à Grenoble de 1924 à 1927 avant d'être envoyé en Indochine. Sa mission : effectuer des recherches sur les métaux essentiels à l'industrie de guerre. À son retour en France en 1940, il choisit le camp de la Résistance en aidant au camouflage des minerais les plus précieux pour la guerre.
Il rejoint le mouvement Combat en 1942 après sa rencontre avec Marie Reynoard [lien vers Marie Reynoard]. Il devient chef de la branche Recrutement-Organisation-Propagande (ROP) de Combat, puis chef départemental sous divers pseudonymes : Mutte, Besson, Piccard, Hourst...
Le 29 novembre 1943, alors qu'il sort de l'Institut d'électrochimie après avoir donné un cours, il est abattu sans sommation par la Gestapo.
Léon Blum

Front populaire
Né en, il est issu d'une famille juive d'origine alsacienne. Il débute sa carrière comme juriste au Conseil d'État et dans le même temps critique littéraire.
Après sa rencontre avec Jean Jaurès en 1905 il s'engage en politique au sein de la SFIO. Figure emblématique de ce mouvement, il défend une vision humaniste et réformiste du socialisme.
Il devient président du Conseil en 1936 avec la victoire du Front populaire aux élections législatives. Il entreprend de vastes réformes économiques et sociales : congés payés, semaine de quarante heures, accords collectifs... Il démissionne en 1937.
Arrêté sur ordre de Vichy en 1940, il est jugé à Riom (Puy-de-Dôme). D'abord transféré au fort du Portalet (Pyrénées-Atlantiques), il est ensuite conduit par les Allemands à Buchenwald le 31 mars 1943, hors de l'enceinte du camp, avec d'autres personnalités politiques.
Libéré en 1945, il dirige le dernier gouvernement provisoire pendant deux mois jusqu'en janvier 1947. Il meurt le 30 mars 1950.
Jean Bocq

"Robert", "Thierry"...
Il est l'un des précurseurs de la Résistance à Grenoble. Il appartient au Groupe Franc Paul-Vallier dès 1943, œuvrant sous les pseudonymes de Robert, Thierry et Jimmy. Il est l'auteur de plusieurs coups de main à l'encontre de collaborationnistes dans l'agglomération grenobloise avec ses compères.
Après avoir échappé à la mort à plusieurs reprises, il est abattu en mars 1944 lors d'une opération menée dans le Vercors, au côté d'Henri Tarze.
Marcelle Boninn

Marcelle et Marcel
Marcelle Boninn est l'une des chevilles ouvrières de la Résistance naissante à Grenoble. Son magasin de photographie Bonnin-Arthaud, 1, rue de Strasbourg, est la boîte aux lettres du mouvement de résistance Combat.
Arrêtée le 27 novembre 1943, elle est emmenée avec son mari à Compiègne, déportée à Ravensbrück, puis au camp de Neubrandenburg. Elle survivra à ces dix-huit terribles longs mois de captivité et sera libérée par l'armée russe le 1er mai 1945. Marcel, son mari, déporté au camp de Buchenwald-Dora, ne reviendra pas.
Rapatriée en France, Marcelle loge à Paris à l'Hôtel Lutetia. L'établissement, qui fut quartier général de l'Abwehr pendant la guerre (service de renseignement et de contre-espionnage de l'état-major allemand), est transformé en centre d'accueil pour les déportés. Elle y retrouve son fils Albert, alors âgé de 13 ans.